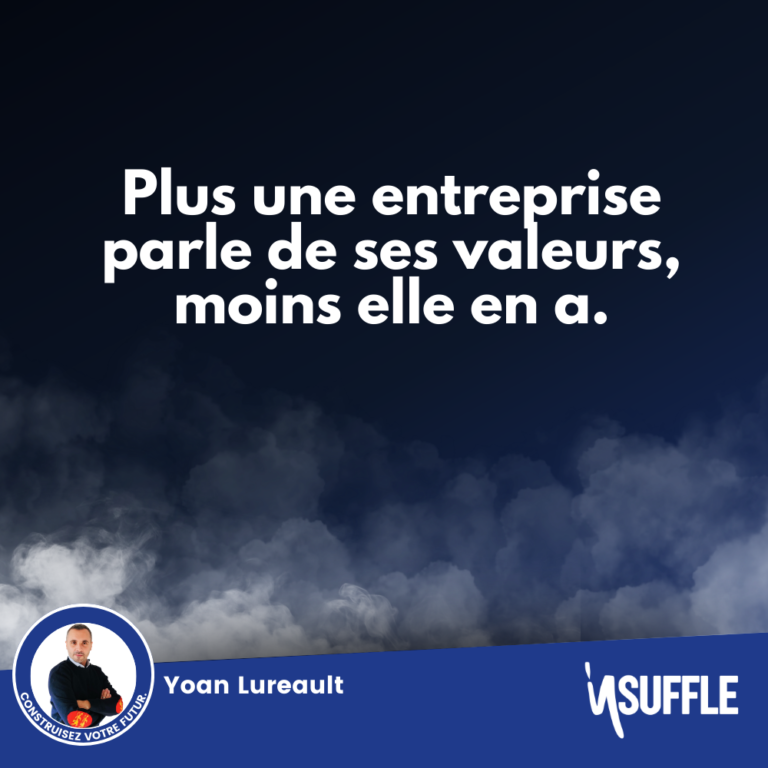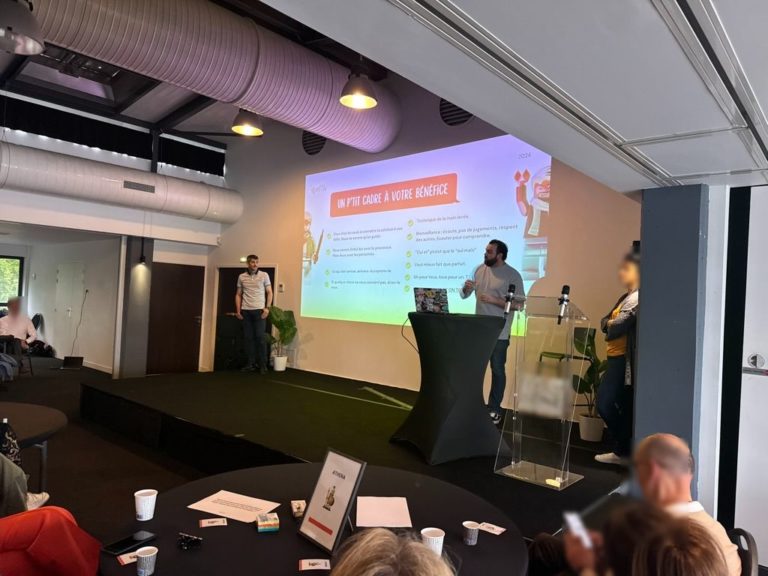Développer une vision stratégique quand on n’a ni objectif ni direction
“Il nous faut une vision.” Le CODIR acquiesce. Tout le monde est d’accord. Une vision, oui, c’est ce qui manque. Puis quelqu’un pose la question qui tue : “Une vision de quoi, exactement ?” Silence. Pas d’objectif clair. Pas de direction définie. Juste le sentiment diffus que l’organisation avance sans savoir où elle va. Que […]