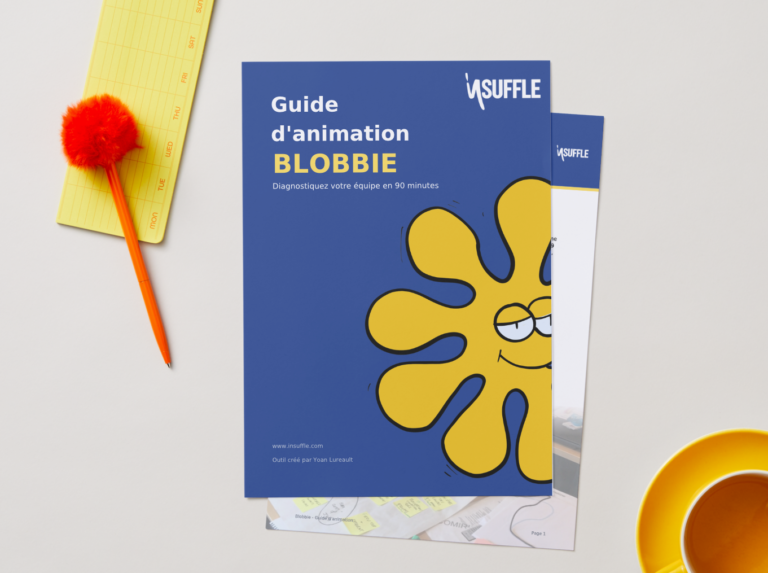Conduite du changement : pourquoi 70% des transformations échouent (et comment éviter le mur)
70% des projets de transformation échouent. Ce chiffre, vous l’avez déjà lu partout. McKinsey, IBM, Harvard Business Review, tout le monde le cite. Mais voilà ce que personne ne dit : ce chiffre n’a pas bougé depuis 30 ans. 30 ans de méthodes agiles, de lean management, de design thinking, de conduite du changement certifiée, […]